|
|
[ Ephéméride ] [ Bric à brac culturel ] [ Actualités ] [ Ma petite vie ] [ Philosophie de vie ]
|
|
|
|
14 janvier 1930-les crédits sont débloqués pour construire la ligne Maginot
14/01/2007 16:38

La loi Maginot est votée et 2900 millions de francs sont alloués à la construction de fortifications sur la frontière nord-est de la France.
Dès 1925 Paul Painlevé a l'idée de ces fortifications. André Maginot, ministre de la Guerre entre 1929 à 1932 est le promoteur de ce vaste projet.
La ligne Maginot longue de 140 km démarre à la frontière Suisse. Elle devait initialement rejoindre la mer du Nord mais la Belgique s'y oppose. En France, le Conseil supérieur de la guerre estime que les Ardennes sont infranchissables suite aux aménagement réalisés entre 1935 et 1939.
En mai 1940, 7 divisions blindées allemandes passent par les Ardennes réputées infranchissables. Elles ne sont que l'avant-garde des 50 divisions du général von Kleist.
| |
|
|
|
|
|
|
|
La peine de mort dans le monde
14/01/2007 16:34
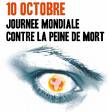
Alors qu'en 1981, lorsque F.Mittérand est arrivé au pouvoir, la France a enfin aboli la peine de mort,alors que bientôt cela sera dans notre constitution ; certains pays dont les Etats Unis d'Amérique, la Lybie (l'affaire des infirmières bulgares) la Chine etc.. continuent à éxécuter des prisonniers. La plupart du temps après un procès baclé, avec des avocats véreux ou incompétents.
[a=http://www.abolition.fr/ecpm/french/petitions.php?ref=18]Pétition contre la peine de mort pour les infirmières et celui ci :[a=http://www.abolition.fr/ecpm/] qui est un site d'actualités sur les pays qui pratiquent encore cette barbarie
| |
|
|
|
|
|
|
|
Anniversaire du Décès de François Mitterand
08/01/2007 18:18

Né en 1916 à Jarnac, en Charente, il monte à Paris en 1934 pour poursuivre des études de droit et de Sciences Politiques. Attiré dans sa jeunesse par la droite nationaliste, il adhère aux jeunesses du mouvement des Croix de feux.
Durant le Front populaire, il fait ses débuts de journaliste dans L'Écho de Paris, opposé à la gauche. Prisonnier en 1940, il s'évade et rejoint Vichy où il participe à différents postes au gouvernement Pétainiste. Il démissionne en 1942 pour rejoindre la résistance sous le pseudonyme de Morland.
Après la libération, il est élu en 1946 député de la Nièvre et participe, sous la IVe République, à 11 gouvernements. Après le retour de De Gaulle en 1958, il devient un des plus farouches opposants à la Ve République.
Lors de l'élection présidentielle de 1965, il met De Gaulle en ballottage, rassemblant 45% des voix au second tour. En 1971, il est élu premier secrétaire du Parti Socialiste et signe, en 1972, avec le Parti Communiste Français, le Programme commun de gouvernement.
Aux Présidentielles de 1974, il échoue de peu face à Valéry Giscard d'Estaing qui est élu au second tour avec 50,7% des suffrages.
Face à Jacques Chirac, il devient en 1981 le 4ème Président de la Ve République (51,7% des voix au second tour).
Son premier gouvernement dirigé par Mauroy prend des mesures "de gauche" : augmentation du Smic, 5ème semaine de congés payés, diminution de la durée hebdomadaire du travail, abolition de la peine de mort et nationalisations.
En 1985, Mitterrand signe avec le Chancelier Kohl l'Acte unique Européen, nouveau départ pour la construction européenne.
Affaiblie par la rigueur économique et l'augmentation du chômage, la gauche perd les législatives de 1986. Mitterrand est contraint de nommer Chirac premier ministre.
C'est la 1ère cohabitation. Il use Chirac et la droite, et gagne en popularité.
Elu en 1988 avec 54% des voix, il devient le premier Président de la Ve république à être réélu au suffrage universel. Son second septennat s'ouvre au centre en faisant appel à son plus vieil adversaire Michel Rocard qu'il nomme 1er ministre.
Toujours fidèle à l'Europe, il favorise la signature des accords de Maastricht.
Déstabilisé, éclaboussé par des scandales, il se trouve à nouveau confronté à la cohabitation en 1993 avec Balladur. Fatigué physiquement par un cancer de la prostate, attaqué sur son passage à Vichy, touché par le suicide de son ami Bérégovoy, il assure malgré tout ses fonctions jusqu'au terme de son mandat. Il ne participe pas à la campagne présidentielle de 1995, si ce n'est pour marquer sa sympathie à Lionel Jospin.
Ce tacticien politicien hors pair, véritable "animal politique" repose désormais à Jarnac aux côtés de ses parents
| |
|
|
|
|
|
|
|
Le lotus
07/01/2007 20:14
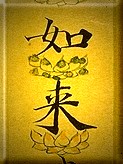
Le Lotus symbolise l’atteinte de la boddhéité
Comme il s’épanouit en puisant sa substance dans la boue de l’étang, il symbolise la capacité pour chacun de transformer son karma “négatif” (souffrance, trouble, désir) en karma “positif” (sagesse, compassion, joie, bienveillance, force vitale...) par l’éveil de son état de bouddha que permet la pratique de Nam Myoho Renge Kyo.
Sa fleur et sa graine se développant simultanément, la fleur correspond à la cause et le fruit à l’effet, ce qui le singularise des autres plantes. Il symbolise ainsi la simultanétité de la cause et de l’effet, la Loi de causalité de l’univers.
Renge signifie donc à la foi Lotus et Loi de causalité de l’univers
“Il existe une Loi merveilleuse de simultanéité de la cause et de l’effet,le sage l’a nommée Myoho Renge” (GZ, p.513)
Ce que l’on peut trouver sur le lotus dans l’encyclopédie Wikipédia, (mis à part les photos)
Le lotus sacré
Nom scientifique : Nelumbo nucifera Gaertn.
Noms communs : lotus sacré, lotus des Indes, lotus Magnolia
C'était la fleur sacrée des anciens égyptiens ; elle l'est toujours dans les religions orientales, Boudhisme, Brahmanisme, dans lesquelles les divinités sont représentées sur un trône en fleur de lotus. Le lotus sacré est la fleur nationale de l'Inde.
Une autre plante du genre Nelumbo est également cultivée, c'est Nelumbo lutea Willd., le lotus d'Amérique, Ã fleurs jaunes.
Description
Le lotus sacré est une plante aquatique, vivace grâce à sa tige en rhizome spongieux, épais, ramifié, portant des tubercules fixés dans le fond de l'étang. Ses feuilles arrondies, peltées, pouvant mesurer jusqu'à 50 cm de diamètre, sont soit flottantes, planes, soit érigées jusqu'à 75 cm au-dessus de l'eau, orbiculaires, en forme de coupe. Une pellicule de cire hydrofuge les recouvre. Les fleurs, de couleur blanc rosé, sont grandes, de 15 à 30 cm de diamètre, et comportent une vingtaine de pétales, et, portées par de longs pédoncules, elles atteignent ou dépassent les feuilles les plus hautes. Le « fruit» composé est constitué par le réceptacle floral charnu ; il ressemble à une pomme d'arrosoir comptant de 15 à 20 alvéoles renfermant chacune un akène de la taille d'une petite noisette.
Distribution
Cette plante est naturalisée un peu partout. Elle est originaire des régions chaudes, principalement d'Asie, (Extrême-Orient, Chine, Corée, Japon, etc., Asie tropicale, Inde, Vièt-Nam, Philippines, Indonésie, etc., Asie occidentale, Iran, Azerbaïdjan, etc.), et du Nord de l'Australie. Elle était déjà décrite par Théophraste dans la flore du Nil.
Utilisation
C'est une plante ornementale ; il en existe des variétés à fleurs doubles. Plus de 80 cultivars sont connus au Japon. la couleur des fleurs varie du blanc pur au carmin rosé selon les variétés.
Les faux fruits séchés, en forme de pomme d'arrosoir, entrent dans la composition de bouquets secs.
C'est aussi une plante alimentaire ; toutes les parties de la plante sont comestibles. Elle est cultivée en Orient pour la consommation des tubercules et des graines, qui sont tous riches en amidon. Les rhizomes, assez fibreux et insipides, sont mangés crus, cuits à l'eau ou frits. On peut en extraire une fécule servant à préparer des potages. Les graines (akènes) sont consommées crues, bouillies ou grillées comme des châtaignes. On en fait des pâtisseries
C'est également une plante médicinale, utilisée aussi en cosmétique.
Culture
C'est une plante aquatique qui aime la chaleur.
La multiplication de la plante se fait par division des rhizomes et tubercules. On peut aussi la multiplier par les graines, qu'ils uffit d'enrober de terre glaise et de jeter dans la pièce d'eau.
Le milieu naturel est la vase du fond des étangs, mais la plante vient bien dans un terreau profond et riche en fumier. Elle résiste aux gelées jusqu'à - 15°C, à condition d'être immergée sous un mètre d'eau. Il faut néanmoins veiller à protéger les rhizomes des gelées lors des hivers très froids.
| |
|
|
|
|
|
|
|
Origine de la galette des Rois
05/01/2007 19:21

A l’époque des Romains, on fêtait les Saturnales. Ces fêtes duraient 7 jours et chacun avait le droit de faire ce qu’il voulait. C’est à ce moment là qu’est venue la tradition d’envoyer des gâteaux à ses amis.
Sous l’Ancien Régime, on appela ça ‘le gâteau des rois’ car on le donnait au même moment que sa redevance (comme les impôts) et il fallait en offrir un à son seigneur.
En 1801, on a décidé que la date de l’épiphanie (qui signifie ‘apparition’) serait le 6 janvier.
L'Épiphanie, ou fête des rois, commémore la visite des trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar venus porter des présents à l'enfant Jésus : de la myrrhe, de l’encens et de l’or.
Pour trouver leur chemin jusqu'à la crèche, les mages ont suivi une étoile plus brillante que toutes les autres. C’est ce qui les a guidés et on l’appelle l’étoile du berger.
Aujourd’hui, la tradition veut que pour le ‘Jour des rois’, on partage un gâteau appelé galette. Selon la région, il s’agit soit d’un gâteau feuilleté soit d’un gâteau brioché.
On a le choix entre :
* la brioche nature, toute simple, en forme de grosse roue avec dessus des pépites de sucre
* En Provence, la brioche, toujours ronde mais fourrée aux fruits confits
* La galette, assez rare aujourd'hui, dite "sèche", simple pâte feuilletée sucrée
* La galette feuilletée fourrée de frangipane, sorte de crème d'amande inventée par Frangipani, beau saucier florentin.
Dans cette galette est dissimulée une fève. Celui qui mange la part contenant la fève est déclaré roi. La coutume veut que le plus jeune de la famille se glisse sous la table pour désigner qui aura quelle part. Ainsi, personne ne peut tricher. On pose une couronne sur la tête du roi qui doit alors choisir sa reine (ou le contraire).
Dans certaines familles, on laisse de côté la "part du pauvre" ou celle du Bon Dieu, offerte le plus souvent au visiteur imprévu.
Une légende raconte que la fève serait née le jour ou Peau d’Ane avait oublié sa bague dans un gâteau destiné au prince. En fait, son utilisation remonte certainement au XIIIe siècle. La fève existe sous de nombreuses formes et dans différentes matières, il y en a pour tous les goûts. Du haricot sec à la fève dorée à l'or fin 24 carats, on peut en trouver en plastique blanc ou, la plupart du temps, en porcelaine. La fève est devenue un véritable objet de collection . Ainsi le Musée de Blain en conserve plus de 10 000. Les collectionneurs sont appelés les fabophiles .
| |
|
|
|
|